Vidéo verticale sur des pompiers déployés en Corrèze. Réalisée pour La Montagne.
Vidéo : qui sont les petites mains du Lovely Brive Festival ?
Vidéo verticale sur le Lovely Brive Festival de Brive-la-Gaillarde. Réalisée pour La Montagne.
Vidéo : passation de commandement au 126 RI de Brive
Vidéo verticale sur le 126e régiment d’infanterie de Brive-la-Gaillarde. Réalisée pour La Montagne.
Pourquoi jeter quand on peut donner ? Une matinée dans la Recyclerie Madeline à Riom
À Riom (63), la Recyclerie Madeline reprend les objets dont vous voulez vous séparer. Ce vendredi, elle est ouverte de 9h30 à 12h. Partons à la rencontre des bénévoles et des clients qui participent au succès de cette recyclerie.
« Les gens sont vraiment entrés dans ce système. Ils ont du mal à jeter », explique Michel Bages, trésorier de la Recyclerie Madeline. Pourquoi jeter lorsqu’on peut donner ? Pour lui c’est évident, le modèle de la recyclerie fonctionne plutôt bien à Riom.
Tellement bien que l’association a dû se déplacer au 66bis Boulevard Étienne Clémentel pour viser plus grand. « Avant on avait 33 mètres carrés, maintenant on en a 250. Et même 250 ça ne suffit pas, il en faudrait deux fois plus », lance le bénévole en rigolant.
Une recyclerie bien remplie
Ces 250 mètres carrés sont effectivement bien remplis. À l’entrée de la boutique, des vases et d’autres objets de décoration intérieure accueillent les clients. Malgré la quantité d’objets apportés, se retrouver est plutôt aisé. « On a de tout donc il faut qu’on soit un peu ordonné », résume Michel Bages.
Après les décorations, place à la culture avec des meubles remplis de films, de séries et de disques. Les dictionnaires et livres de cuisine occupent quelques étagères en bois.

Pour se divertir, les enfants et les adolescents peuvent compter sur un rayon jeux plutôt conséquent. À neuf heures, une femme recherche justement de quoi occuper ses enfants et regarde les peluches et jeux de société sur les étagères.

Au fond de la boutique, sous une immense peinture représentant des cyclistes, une étagère pleine de livres offre de quoi se cultiver l’esprit. Il y en a pour tous les goûts. Polars, romances, philosophie. Quelques étagères plus loin, des outils de jardinage et de travaux sont suspendus : tuyaux, pots de fleur, casque de chantier.
Côté décoration, la recyclerie propose d’innombrables objets de différentes tailles et usages. Toiles, lampes, horloges, bateaux en bois, Tour Eiffel en métal… « Moi j’ai toujours été pour les vieux objets », explique un habitué de la recyclerie en souriant. Il tient dans la main une poule en opaline. La partie inférieure de l’objet est manquante mais cela lui importe peu. « Le tout c’est d’accumuler les petits trucs et un jour on trouve le reste », lance-t-il d’un air convaincu.

Il consulte ensuite les nombreux autres objets présents sur l’étagère à la recherche d’un éventuel coup de cœur. Selon lui, certains articles n’ont pas leur place ici. « Les gens vont acheter des objets chinois. Je suis stupéfait de voir que les gens payent pour ces choses », regrette-t-il. Difficile d’affirmer avec certitude le nombre d’objets produits en Chine. À l’inverse, d’autres affichent fièrement leurs lieux de production : Italie, France…
Un modèle qui séduit
Pauline est une adepte de ce mode de consommation. « J’ai l’habitude d’aller aux Mains Ouvertes à Gerzat (63) », explique la jeune femme en référence à cette autre association qui allie don et vente d’objets. « Aujourd’hui, je découvre la Recyclerie Madeline », ajoute-t-elle.
« Ma fille va avoir un bébé donc je vais voir si je trouve quelque chose », explique Lydia, une autre cliente. Pour elle, la recyclerie « évite le gâchis. Ça évite qu’on jette ».
« J’aime le concept parce que c’est des objets de seconde main », dit Pauline en souriant. Le principe de la recyclerie lui plaît car il a peu d’impact sur l’environnement. « J’ai eu une prise de conscience un peu tardive de l’urgence pour l’environnement », avoue-t-elle. Elle s’est interrogée sur sa propre consommation et essaye désormais de « boycotter les achats et la production ».
Ce modèle de commerce est aussi bénéfique au niveau du porte-monnaie. « Les gens vont avoir de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Or, ici tout est à petit prix », conclut Pauline.
Vers 11 heures, les clients sont plus nombreux. Ils s’arrêtent devant les rayons, cherchant la bonne affaire. Au rayon cuisine, une dame compare longuement des poêles avant de repartir.
Quatre fois par an, la recyclerie organise des braderies. « On fait tout à moitié prix », raconte Michel Bages. La boutique se fait aussi connaître à certains événements. « L’année dernière on a fait le marché solidaire à Riom. Ça avait bien marché, c’était très sympa », ajoute-t-il.
Les visages derrière la recyclerie
Sept ans après sa création, qui se trouve derrière cette florissante recyclerie ? Un groupe de bénévoles ravis de pouvoir revaloriser des objets bien souvent jetés.
Christine, bénévole depuis six mois, est convaincue par ce modèle. « Je venais régulièrement en tant que cliente. Il y avait une affiche expliquant qu’ils recherchaient des bénévoles et je me suis inscrite », dit-elle en souriant.

Des bénévoles comme elle, il y en a une trentaine « qui tournent sur six matinées », raconte Michel Bages avant de saluer un client entrant dans la recyclerie. L’un des objectifs de l’association était de créer de véritables postes. « On a créé deux emplois, l’un à l’administratif et l’autre à l’atelier », explique le trésorier.
Dans la boutique, quelques bénévoles s’affairent : réorganisation des rayons, ajout de nouveaux objets. Dans l’atelier situé à l’arrière, les réparations de vélos et autres objets s’enchaînent. « On les nettoie et on les répare si besoin puis on les revend », explique le trésorier.

La recyclerie fait aussi des partenariats. « On va chercher tout ce qui peut être réparé, tout ce qui marche bien mais que les gens ont jeté », explique Michel Bages. La recyclerie s’ouvre par exemple aux livres : « on vient d’avoir un partenariat avec Éco-livres ». Cela explique la quantité d’ouvrages sur les étagères. « On essaye de travailler un peu avec tout le monde », résume-t-il.

Midi, déjà l’heure de repartir. Les clients continuent d’entrer et sortir, signe d’un modèle qui a de beaux jours devant lui. « Les recycleries c’est l’avenir », lance Pauline dans un sourire.
Les PFAS du quotidien bientôt interdits ?
Chronique radio du 18 février 2025 par Pierrick Mouëza :
Tout de suite, Pierrick va nous parler des PFAS (pifaces) qui reviennent dans l’actualité cette semaine. (présentateur)
En effet, nouveau rebondissement dans l’affaire de la pollution aux substances per- et polyfluoroalkylées, les fameux PFAS. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, soutient la proposition de loi portée par les Verts visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant ces PFAS.
Les polluants éternels sont au cœur de l’actualité depuis plusieurs années. Leur principal problème : ils polluent l’environnement de façon massive et permanente. C’est donc devenu un enjeu écologique et de santé publique.
« J’assume d’interdire les PFAS pour des usages du quotidien », explique la ministre. Le projet de loi va dans ce sens et prévoit d’interdire les PFAS quand ils ne sont pas essentiels et qu’il existe des alternatives. C’est le cas pour les textiles et les produits cosmétiques. Mais l’interdiction ne concerne pas tous les objets du quotidien comme les poêles antiadhésives. De quoi faire déchanter tous les amateurs de cuisine qui nous écoutent.
Le texte revient donc ce jeudi à l’Assemblée nationale, après avoir été adopté au Sénat en mai 2024.
Et les PFAS concernent aussi notre santé ? (présentateur)
Effectivement, les PFAS contaminent l’eau et donc notre santé. En 2022, une étude suédoise montre que l’eau de pluie est fortement polluée. Mais ça ne s’arrête pas là. L’eau potable est aussi concernée, notamment en France.
Ce mardi, l’UFC-Que Choisir et Générations Future révèlent que des PFAS ont été détectés dans 29 des 30 prélèvements analysés par les associations, y compris dans de grandes villes comme Paris, Lyon et Bordeaux. Les deux associations appellent donc les autorités à agir.
Au niveau européen, une enquête du journal Le Monde en collaboration avec des médias européens a permis de créer une carte d’Europe de la contamination par les PFAS. Cette enquête montre que 23 000 sites sont contaminés à des doses égales ou supérieures à 10 nanogrammes par litre. C’est justement à ce niveau de pollution que les autorités sont censées prendre des mesures.
Face à l’urgence, Agnès Pannier-Runacher s’engage à mettre en place une redevance pour financer la dépollution des eaux contaminées. Cette mesure permettra d’utiliser des « dispositifs de filtration des points de captages d’eau potable ».
En tout cas une telle loi représente une étape décisive dans la lutte contre cette pollution invisible même si certains regrettent que toutes les formes de PFAS ne soient pas interdites.
Sources: UFC-Que Choisir, France Info, Le Parisien.
Saint-Colomban : l’interminable bataille du sable
À Saint-Colomban, au sud de Nantes (44), des citoyens se sont réunis au sein d’un collectif. Leur but, défendre les terres environnantes contre les géants du ciment qui tentent d’étendre leurs exploitations de sable.
« La Tête dans le sable ». Voilà le nom de l’association qui lutte pour protéger l’environnement autour de la commune. Annie Le Poulen est l’une des 13 coprésidents de l’association, composée de riverains des carrières de sable. Elle a accepté de revenir sur cette véritable bataille du sable qui semble stagner malgré quelques avancées.
Tous se battent contre les géants du ciment. LafargeHolcim, leader du secteur du ciment et GSM, filiale de HeidelbergMaterials, deuxième mondial, possèdent chacun une sablière proche de la ville de Saint-Colomban. Mais leur appétit en sable ne s’arrête pas là.
L’exploitation du sable, un danger écologique
« Le sable […] est la deuxième ressource la plus exploitée dans le monde après l’eau », rappelle le Commissariat général au développement durable (CGDD). « Son extraction, souvent peu réglementée, représente un coût environnemental conséquent », continue l’instance.
À Saint-Colomban, ce coût environnemental se traduit visuellement par l’apparition des nappes phréatiques en surface, sous forme d’étangs. Cela participe à la « fragilisation de la nappe » et entraîne aussi une forte « évaporation » d’après le site du ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires. L’environnement autour des sablières n’a donc plus accès à cette eau ou alors, de manière dégradée.
La fin d’exploitation de la sablière de GSM pose aussi question. Une fois le sable épuisé, les entreprises comblent les trous qu’elles ont créé. « Il y a des déchets inertes la plupart du temps », détaille Annie le Poulen. Mais elle doute de la neutralité des matériaux car « toute matière plongée dans l’eau se dégrade forcément », continue la militante.
Une bataille administrative pour l’environnement
Le collectif mène une bataille acharnée contre ces exploitations. Première victoire pour les militants ? Les deux entreprises présentaient leurs nouveaux projets d’extension de sablières en même temps mais tout ne s’est pas passé comme prévu.
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a demandé aux deux groupes de mener « une étude d’impact conjointe » au lieu d’une simple étude par chacune des entreprises pour leur propre projet. Cette étude vise à connaître les effets des sablières sur l’environnement.
Lafarge Holcim renonce donc « à son projet d’extension pour l’instant », détaille Annie Le Poulen. Toutefois, elle reste prudente quant à la suite des événements. « Ils se sont peut-être mis d’accord pour que GSM démarre, parce qu’il était urgent de le faire, et que Lafarge revienne après », tempère-t-elle.
Plus récemment, une victoire contre GSM a été actée. « Le tribunal administratif donne raison à l’association dans l’un des dossiers qu’elle a déposé », déclare Annie Le Poulen. « On a fait un recours contre la forme de la concertation préalable à la modification du PLU (plan local d’urbanisme) », continue-t-elle.
Cette décision ralentit donc le projet de GSM. « Ce qui est embêtant c’est que ça ne se joue pas sur une idée de la société (ici, l’écologie) mais sur une erreur administrative », déplore la militante.
Au niveau local, cette affaire crée des tensions. Patrick Bertin, le maire de Saint-Colomban, « fulmine face aux attaques de La Tête dans le sable », relevait Ouest France dans un article.
Une ville divisée par le sable
À Saint-Colomban et les villes alentours, de nombreuses personnes soutiennent les sablières, un atout pour l’activité économique locale. Le collectif peine donc à être entendu. « On passe un peu pour des réactionnaires anti-tout donc on n’arrive pas à discuter avec les gens de la commune », déplore Annie Le Poulen.
Ici, deux questions se posent. Faut-il soutenir l’exploitation du sable, créatrice d’emplois et de richesse ? Ou bien renoncer à une exploitation qui dégrade l’environnement ?
Au bout du compte, deux camps se forment, comme séparés par une dune de sable qui rend inaudible toute discussion. « Les gens du bâtiment et des travaux publics ne nous aiment pas du tout parce qu’ils considèrent que c’est leur gagne-pain d’avoir du sable à proximité », poursuit Annie Le Poulen. Elle reste compréhensive vis-à-vis de cet argument mais constate que personne ne vient discuter du problème avec le collectif.
Il est donc difficile de dire combien de temps ce statu quo durera.
Pierrick Mouëza
Vichy: un marché qui a du succès
Reportage de journal télévisé sur un marché de la ville de Vichy.
600° : une exposition sur les incendies de l’été 2022 en Gironde

Le collectif Les Associés présente l’exposition 600° jusqu’au 17 mars prochain à Bordeaux. C’est l’occasion de revenir sur les feux de forêt survenus en Gironde en 2022. Cette exposition immersive permet d’en comprendre les conséquences sociales et environnementales.
« 28 833 hectares partis en fumée, 46 615 personnes évacuées, 4200 pompiers mobilisés » lors des incendies de l’été 2022 en Gironde. Voici le bilan dressé par le collectif Les Associés à l’origine de l’exposition 600° qui se déroule à Bordeaux. 600℃, « c’est la température des sols qui continuent encore aujourd’hui de se consumer », explique le collectif. Cela donne le ton de l’exposition qui rend compte des bouleversements subis par ce territoire ravagé par les incendies.
Une immersion dans la forêt landaise
Dès l’entrée dans l’ancienne église, les spectateurs sont plongés dans une ambiance sombre, sobre et mélancolique. L’éclairage, les photographies, l’emplacement théorique des arbres détruits marqué sur le sol, permettent de se remémorer l’ampleur des événements. Sons et lumières servent aussi à la reproduction d’une scène d’incendie. Le bruit des flammes qui crépitent et l’alternance du rouge, du orange et du jaune donnent l’impression que la salle est transportée dans la forêt des Landes, pendant les incendies.
Des témoignages directs
« Je me souviens de la fumée noire qui envahissait tout », « c’était comme la nuit en plein jour », détaillent des extraits de témoignages recueillis par le collectif dans la commune de Landiras (33) en 2023. Chaque visiteur lit attentivement la longue liste de commentaires qui rappellent la brutalité de la catastrophe et le choc pour les habitants de Landiras et de la Teste-de-Buch (33).
Le public semble captivé par les photographies qui montrent l’ampleur du désastre. L’image d’une partie de la forêt encore intacte la nuit sous un ciel orangé, un pompier entouré par une forêt calcinée sur des kilomètres, tels sont les témoignages directs de l’épreuve à laquelle les habitants de la région ont fait face.
Une photo marque les esprits. On y voit une fougère pousser sur un tronc de pin calciné, contraste frappant entre la vie et la mort. La première s’est arrêtée en 2022 pour laisser place aux cendres et à la fumée. La seconde a été effacée par cette nouvelle trace de vie qui « reprend son cours », autant pour les habitants que pour la forêt.
Des incendies qui soulèvent beaucoup de questions
« Les méga-feux mettent à nu les déséquilibres de notre société », rappelle sobrement le collectif. Les Associés invitent le public à la réflexion. « Aménagement du territoire, gestion du foncier, arbitrages budgétaires », voilà des facteurs qui ont pu jouer sur l’ampleur des feux de 2022, explique un panneau. Ce sont ces mêmes incendies qui, aujourd’hui, questionnent notre rapport à l’environnement et notamment au réchauffement climatique. Ce portrait d’une région dévastée révèle aussi « le chemin à parcourir dans la prise de conscience des bouleversements auxquels nous avons à faire face », selon les termes du collectif. Les visiteurs passent ainsi d’image en image et de description en description dans une atmosphère plutôt pesante. Certains discutent avec l’un des photographes du collectif après avoir vu les images.
Les Associés, entre création et restitution
« Il y a systématiquement la nécessité de dresser le portrait du territoire […] après un bouleversement », explique ce photographe, en référence aux différents projets des Associés. Les communes ravagées par le brasier en 2022, ont subi l’impensable. Le collectif souhaite donc donner la parole à ceux qui ont vécu cet événement sans précédent. L’équipe s’intéresse aussi aux conséquences des feux de 2022 car « l’actualité s’en est allée sur d’autres fronts », alors même que « les acteurs locaux continuent de lutter », écrit-elle. C’est une façon de ne pas oublier que les feux ont détruit l’environnement mais aussi le lieu de vie que représente la forêt des Landes.
Après un passage dans la ville de Bordeaux jusqu’au 17 mars 2024, le collectif souhaite installer l’exposition dans les territoires concernés, « en espace extérieur, dans la forêt, dans les centres-villes », explique le photographe. Cette résidence d’artistes permet d’amener « la culture là où il n’y a pas nécessairement d’infrastructures », ajoute-t-il.
Selon lui, le travail n’est pas fini. Il y a « encore un an et demi, deux ans » avant de présenter l’exposition finale qui sera accompagnée d’un livre et d’un film photographique.
Pierrick Mouëza
15 ans de Mediapart: Passage à Clermont-Ferrand

Samedi 7 octobre 2023, Mediapart était de passage à Clermont-Ferrand, une étape de son tour dans quinze villes de France pour célébrer ses quinze ans, fêtés le 16 mars 2023.
Une variété de sujets au cœur de l’actualité
Ce samedi 7 octobre à la Coopérative de Mai de Clermont-Ferrand, une partie de l’équipe de Mediapart a organisé plusieurs discussions autour de la presse, le métier de journaliste et le travail de Mediapart. Au programme, quatre présentations ont eu lieu. D’abord, l’introduction par le co-fondateur de Mediapart, Edwy Plenel. Ensuite, une discussion autour du travail local et national et du lien entre Paris et les autres régions avec Nicolas Cheviron, correspondant de Mediapart et Stéphane Alliès, responsable du pôle édition du journal. La séance s’est poursuivie avec Ellen Salvi du pôle politique et Antton Rouget du pôle enquête de Mediapart autour du travail collectif entre ces deux pôles. Stéphane Alliès et Carine Fouteau, elle aussi journaliste à Mediapart, ont ensuite présenté les attentes de la presse vis-à-vis du gouvernement. L’événement s’est clôturé avec des questions du public et la rencontre des journalistes par la suite.
Un journal ancré dans le territoire français
Créé en 2008, Mediapart vit grâce au financement de ses 215 000 lecteurs comme le rappelle Edwy Plenel lors de son introduction, une façon de montrer le besoin de proximité entre le journal et ses lecteurs. C’est grâce à eux que Mediapart est actuellement le troisième quotidien national français en terme d’abonnés numériques, derrière Le Monde et Le Figaro.
Nicolas Cheviron est correspondant dans la région Auvergne-Rhône Alpes chez Mediapart. Pour lui, la principale difficulté lorsqu’on s’installe dans une nouvelle région, c’est la construction d’un réseau pour collecter des informations. Malgré tout, au fil du temps, son réseau s’est développé. Il s’est attaché à couvrir des problématiques délaissées par les médias nationaux implantés en région parisienne comme la « chasse », ou « l’environnement » selon ses termes.
L’indépendance de la presse, un enjeu clé
Pour Antton Rouget du pôle enquête, il y a un enjeu lié à l’indépendance « capitalistique » et « économique » comme dans tous les médias. La rédaction est-elle cloisonnée par rapport aux actionnaires du journal? Le propriétaire a t-il un droit de regard sur ce qu’écrivent les journalistes? Antton Rouget pousse la réflexion plus loin en expliquant qu’il faut tenir compte des liens entre le journaliste et la source si l’on veut éviter une « dépendance » du premier envers la seconde. Pour sa part, Carine Fouteau se félicite de l’indépendance de Mediapart. Mais selon elle, les aides publiques à la presse « enrichissent les plus riches » aux dépens des journaux récemment créés et des médias indépendants.
Antton Rouget rappelle aussi certaines règles de déontologie pour ne pas être attaqué en diffamation devant la justice. L’enquête doit d’abord être un minimum « sérieuse ». Cela paraît logique mais il est important de le rappeler. Par exemple, le journaliste doit s’appuyer sur diverses sources (personnes, documents…) mais aussi recouper les informations qu’il collecte. Surtout, selon Antton Rouget, le journaliste se doit de « respecter le contradictoire », en contactant la personne mise en cause dans une enquête avant la publication de celle-ci. Cela peut ainsi éviter une éventuelle poursuite en diffamation concernant des propos ou des actes dont l’intéressé n’a jamais été à l’origine.
La faiblesse économique de la presse française
Reprenons le cas des aides publiques à la presse. Selon le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil), en 2008, ces aides représentaient 12,9% du chiffre d’affaire de la presse française contre 16,4% en 2015 et 23,3% en 2021. Le constat est sans appel, le montant de ces aides ne cesse d’augmenter. Pour Stéphane Alliès certains titres seraient même « sous perfusion ». Autrement dit, sans les aides publiques, l’activité de certains titres de presse serait compromise. Le partage des aides pose aussi question. Stéphane Alliès cite notamment Les Échos et Le Parisien qui ont touché ensemble 14 millions d’euros en 2022. Or, cette année-là, selon les chiffres du Ministère de la Culture, 370 titres ont obtenu ces aides. Cela fait un total de 28 millions d’euros. Certains médias peuvent donc se sentir lésés. Stéphane Alliès clôture cette conférence en appelant à répartir les aides publiques à la presse « de façon équitable et avec de la transparence ».
Voilà une conférence riche en informations pour qui s’intéresse au travail journalistique et ses problématiques. L’équipe de Mediapart continue actuellement son tour de France dans les villes suivantes: Villeurbanne — 28 octobre, Toulouse — 18 novembre, Bordeaux — en novembre, Lille — 2 décembre, Bruxelles — 16 décembre.
Sources: Mediapart, Ministère de la Culture, Spiil.
Pierrick Mouëza
L’industrie musicale face à l’IA
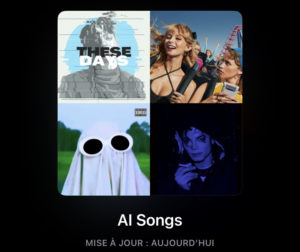
Après l’apparition d’outils comme ChatGPT pour la génération de textes en langage naturel ou encore DALL-E et MidJourney pour la création d’images, d’autres outils permettant de recréer librement la voix de vrais artistes sont aussi apparus.
L’intelligence artificielle aux Grammys ?
« Heart On my Sleeve » voilà le titre d’une chanson qui fait le tour des réseaux sociaux en ce moment et ce, pour plusieurs raisons. L’auteur a utilisé un outil d’intelligence artificielle (IA) et s’en est servi pour modeler la voix de Drake et celle de The Weeknd. La chanson a même été soumise aux Grammy Awards. Ces caractéristiques ont intrigué les réseaux et contribué à la popularité du morceau, à tel point que Harvey Mason Jr, le directeur de la Recording Academy, entreprise à l’origine des Grammys Awards, a déclaré que la chanson était éligible pour le concours, étant écrite par un humain.
Seul problème, l’auteur de la piste, connu sous le nom de Ghostwriter977 a utilisé ces voix sans le consentement des deux artistes. Le 8 septembre, Harvey Mason Jr est finalement revenu sur ses propos en expliquant que les deux artistes n’ont jamais donné leur accord pour apparaître sur un tel projet. Le morceau « Heart On My Sleeve » sorti en avril 2023 n’est donc pas éligible car les deux voix n’ont pas été obtenues de manière légale, il a également été retiré des plateformes de streaming sous la pression des labels.
Vers un début de législation ?
Plus largement, cette affaire montre qu’il existe une zone grise de la législation autour des outils d’intelligence artificielle dans le secteur de la musique. L’IA engendre des problèmes de droits d’auteurs liés à l’imitation des voix mais aussi à la rémunération des artistes et des majors, c’est à dire les principaux labels sous les noms desquels les artistes publient leurs projets. Tous ces éléments montrent que l’industrie de la musique n’est pas encore totalement prête à accueillir l’IA bien que des normes apparaissent déjà. Ainsi, la Recording Academy a commencé à établir de nouvelles règles concernant la soumission des chansons, seuls les humains étant éligibles à une nomination aux Grammys.
Apport de l’IA pour la culture
Pour autant, « Heart On My Sleeve » n’est pas la première piste réalisée via de tels outils. De nombreux morceaux d’artistes, vivants ou décédés, réalisés par des fans ont fait surface sur Internet ces derniers mois. Par exemple, la voix du défunt rappeur américain Juice WRLD apparaît dans « These Days » avec un résultat assez proche de la réalité. Même Paul McCartney du célèbre groupe des Beatles a déclaré avoir utilisé l’IA pour un nouveau projet. Plus récemment, la voix de l’artiste belge Angèle a été utilisée sur « Saiyan », un titre initialement interprété par les rappeurs français Heuss L’enfoiré et Gazo. Cette nouvelle version de la chanson a d’ailleurs cumulé plus de trois millions de vue sur YouTube en seulement un mois, preuve d’un certain succès de cette reprise.
Bien que l’intelligence artificielle ait déjà été utilisée auparavant comme dans le morceau « Daddy’s Car », créé dans le style des Beatles et posté en 2016 par Sony CSL (Computer Science Laboratories), le futur de la musique se joue maintenant avec une question centrale:
Comment intégrer l’intelligence artificielle dans le monde de la musique pour que personne ne soit lésé ? Que ce soit les artistes, les compositeurs, les producteurs/beat-makers, les maisons de disque et enfin les auditeurs, tous sont concernés par cette avancée technologique.
Une affaire à suivre donc…
Sources: nytimes, franceinfo, telerama.
Pierrick Mouëza


